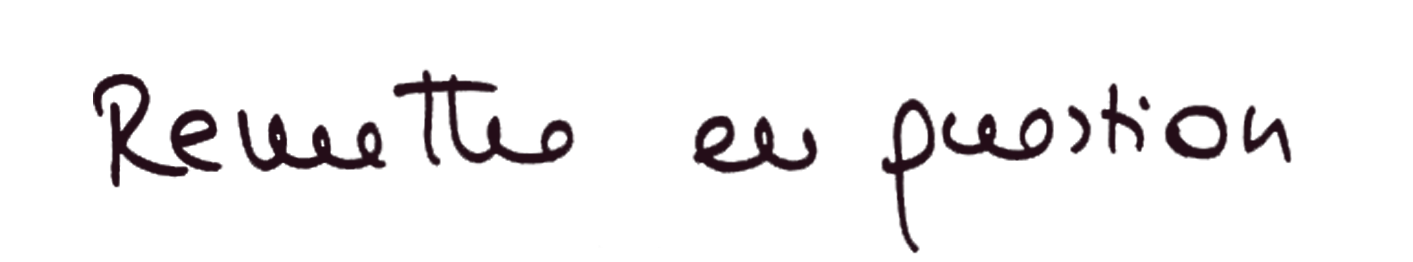Parler d’amour au bord du gouffre
de Boris Cyrulnik

Enquête sur la vie, l’amour, l’alchimie du bonheur.
Cet essai, étayé des dernières recherches sur les conséquences des traumatismes, insiste sur les remaniements affectifs possibles lors de rencontres amoureuses et sur la fonction de la résilience dans la formation d’un couple.
La fin de l’adolescence est une période sensible, où chacun rejoue son passé, s’engage avec tout ce qu’il a acquis dans son enfance afin de réaliser ses rêves.
« Qui suis-je pour me faire aimer ? » est alors « la » question.
Si Boris Cyrulnik n’est pas le premier à parler de résilience, il est celui qui illustre ce concept avec le plus d’enthousiasme et d’humour. Le changement est le sujet majeur de son enquête, en plusieurs volumes, sur la vie, l’amour et l’alchimie du bonheur.
Comme dans ses ouvrages précédents, privilégiant les étapes de croissance depuis la vie intra-utérine jusqu’au premier baiser, les questions qu’il pose sont :
Comment vivre quand on est désespéré ?
Comment rebondir après un effondrement ?
Comment goûter la vie alors qu’on souffre d’escarres ?
Y a-t-il une vie après un fracas et une parole après la sidération ?
Pour répondre, l’auteur nous livre dans Parler d’amour au bord du gouffre, des réflexions, des témoignages et des exemples inoubliables.
Boris Cyrulnik commence par distinguer trauma et traumatisme.
Le trauma, c’est le choc, l’horreur, le fracas qui laissent hébété.
Le traumatisme, c’est l’idée qu’on se fait de ce qui est arrivé. C’est la représentation élaborée pour donner du sens aux événements et aux objets. Comment, alors, passer de l’expérience du premier – une sorte de mort – à celle du second ? Est-elle une seconde chance ? Par la narration, par les mots, le récit, cet anti-brouillard, comme le nomme l’auteur, est un véritable travail. Il s’agit de raconter une histoire de vie (de mort ?) à d’autres, le plus souvent incrédules. De métamorphoser l’événement par une double opération : placer les événements hors de soi et les situer dans le temps. Enfin, de créer une autobiographie constituée d’images et d’anecdotes, d’émotions et d’indicible et ce, pour répondre à la question : Comment ai-je fait pour m’en sortir ?
« Quand le sujet ne peut pas faire ce travail parce qu’il est trop jeune, parce que l’entourage le fait taire ou parce que son cerveau abîmé, par un accident ou une maladie, ne lui permet plus la représentation du temps, alors la résilience est possible puisqu’il s’agit, très simplement, de la reprise d’un type de développement après une agonie psychique ».
En effet, comment éviter de transmettre le traumatisme à ses enfants et petits-enfants ? Quel est le prix à payer pour cette fonction de filtre ? Le déni ? Le courage ? Le travail ? La résilience ?
Comment choisir ce chantier d’espoir, au coût parfois exorbitant, plutôt que le malheur comme destin, avec, souvent dans ce dernier cas, l’approbation de l’entourage affectif ou culturel ? « On peut rester mort, c’est la solution la plus confortable, c’est même celle que notre culture accepte le plus volontiers … Trop de compassion condamne à la mort psychique, et si par malheur vous vous bagarrez pour revenir à la vie, vous risquez de provoquer un scandale : Quoi ! il danse, il est heureux en revenant du cimetière ! {…}
Mais un jour, il faudra bien cesser de vivre avec la mort et, pour retrouver un peu de bonheur, il faudra bien se dégager de ce passé blessé. Alors on agit, on s’engage, on parle d’autre chose, on écrit une histoire à la troisième personne afin de s’exprimer à la bonne distance, celle qui permet de dominer l’émotion et de reprendre possession de son monde intime ».
Par ailleurs, Boris Cyrulnik oppose carence affective et prison affective, toutes les deux à l’origine d’effondrement psychologique. Ce trauma est visible pour celui à dû traverser un désert, vivre abandon, trahison ou négligences. Il reste souvent invisible à celui et pour celui à qui on a tout donné, qui est resté prisonnier d’une surcharge affective qui l’a engourdi et isolé du monde. Voici ce qui expliquerait d’autres soumissions conjugales, politiques, sectaires après le départ (la fuite ?) du champ clos familial. Gavé de cette carence dorée, il n’a pu éprouver le manque et le remplir de rêves, d’aspirations et de désirs. D’enfant idolatré et conformiste, il est parfois devenu tyran domestique et souvent soumis social. « Moi, je ne sais que recevoir ». Pauvre petite fille riche !
Que sont les figures d’attachement et en quoi ont-elles une importance vitale ? Sont figures d’attachement, toutes les personnes et tous les objets qui nous ont permis, enfant, de construire un sentiment de sécurité, grâce à la permanence et à la stabilité de la relation et à la fiabilité du lien. C’est ce dont nous avons besoin à tous les âges pour élaborer une représentations de nous-même, « confiant et aimable ». C’est ce qui laisse en nous une empreinte qui va influencer notre vie émotionnelle ultérieure. C’est surtout ce qui nous a donné-avant le malheur des ressources intimes nous permettant ensuite d’accepter des tuteurs de résilience et de reprendre notre travail de restauration.
A l’aide de quelques concepts-clefs : rituels, fantômes, transmissions, tuteurs de résilience, styles affectifs, l’auteur éclaire des sujets tels que les parents battus, le clivage fréquent entre succès social et souffrance intime, la dépression, les mémoires avec ou sans images, la répétition des traumatismes, des violences ou des images.
De quoi la résilience nous sauve-t-elle ? De la tyrannie des choses, d’abord. Car un être humain ne pourrait pas vivre dans un monde sans mémoire ni rêves. La résilience s’appuie sur les représentations que nous inventons, préfère « ce fil qui coud les éclats du réel ».
De la mort, bien sûr. De l’anesthésie psychique. De la répétition. De toutes ces tentations plus ou moins menaçantes comme le montrent les exemples de cet ouvrage. Boris Cyrulnik insiste sur la distinction entre le trauma choc, daté, qui invite à la mise en place de procédures de résilience et le trauma insidieux, inscrit dans la mémoire, comme un apprentissage inhibiteur du développement et donc difficilement compatible avec la résilience.
La résilience, qu’est-ce que c’est ?
C’est la liberté « tricotée », comme dit l’auteur, ou retrouvée. C’est un autre type de développement initié grâce aux autres (famille, tuteurs, culture … ). C’est le choix de la vie. Certaines familles se replient sur la souffrance, d’autres combattent l’adversité. C’est « une troisième voie qui évite l’identification à l’agresseur autant que l’identification à l’agressé. Dans un processus résilient, il s’agit de découvrir comment on peut revenir à la vie sans répéter l’agression ni faire une carrière de victime ».
C’est l’apprentissage de la relation et de la confiance. C’est, grâce à une relation intime, amicale ou psychologique, la capacité à faire évoluer l’image de soi-même et des autres. C’est, grâce à cette image, le courage de s’engager dans la vie active et sociale.
C’est ce qui, à travers la richesse du banal, permet de tisser un nouveau lien et de mettre au monde une autre existence. Un souvenir résilient, c’est celui qui ne fait pas revenir la souffrance passée pour la ruminer mais pour la transformer, en faire un roman, un essai, un engagement, une œuvre, une générosité tournée vers les autres. C’est celui qui métamorphose le passé et redonne la maîtrise des sentiments.
Boris Cyrulnik ne s’adresse pas qu’à ceux qui ont été victimes d’horreurs historiques, naturelles ou personnelles reconnues comme telles. Cette lecture nous concerne tous, petits et grands, victimes ou héritiers directs ou indirects d’un traumatisme, d’un drame, d’un secret, d’une violence.
Aliette de Panafieu